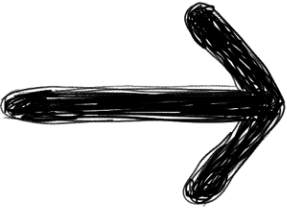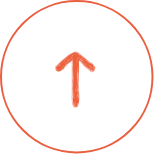Non, ce n’est pas parce que vous « allez mieux » que vous allez forcément bien
On revient de loin
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ?
Reprenons depuis le début, si vous voulez bien : inventé par le Docteur Boris Cyrulnik à la fin du XXème siècle, le terme “résilience” est entré récemment dans le champ du vocabulaire utilisé pour parler de santé mentale. Et il connaît ces derniers temps un succès fulgurant.
Ce sont les travaux cliniques réalisés autour des liens de l’attachement (qu’on vous décrypte ici), qui ont inspiré la définition donnée par l’auteur du terme en 1999. Selon lui, la résilience peut se définir comme la « capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable en dépit du stress ou d’une adversité qui comporte normalement le risque grave d’une issue négative ».
Ce qu’on en pense a priori ? Que c’est une bonne chose. Car son omniprésence raconte quelque chose de ce monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous devons en permanence apprendre à nous reconstruire. À soigner nos blessures.
Allant plus loin encore, le Docteur en Psychologie précise en 2004 que la résilience est une « reprise d’un type de développement après une agonie psychique ». Which means, si vous avez tout bien suivi, que pour qu’il y ait résilience il faut qu’il y ait traumatisme. D’où l’utilité de ce terme, on vous le concède. Ce qui n’est pas sans nous faire penser aux vers de l’auteur Martin Page dans son livre Un accident entre le monde et moi (Ed. Bruno Doucey) :
« l’éthique c’est juste ce que tu sais
quand tu en as pris plein la gueule ».
La résilience, un super-pouvoir ?
Ce qui peut-être questionné en revanche, c’est la manière dont Cyrulnik aborde cette notion.
Car celui qui se définissait lui-même comme un survivant de traumas, considère en effet (grosso modo) que la résilience est physiologiquement inscrite en nous (comme l’existence de votre nez, si vous voulez).
Allant plus loin, il affirme que « La résilience n’est pas un simple retour à un équilibre antérieur. Au contraire, elle mène ceux qui traversent ce processus à un style de vie d’une qualité particulière, grave et extraordinaire, qui rend différents ceux qui ont souffert et ont agi sur leurs souffrances. »
Sous-titre : il y aurait, à travers le fait d’avoir vécu un ou des traumatismes, la possibilité du développement d’une faculté particulière, qui impacterait grandement nos vies et nos dispositions émotionnelles. Et nos blessures feraient de nous, en quelque sorte, qui nous sommes.
Ce qui n’est pas sans nous faire penser à cette citation de Stephen Kinley : « People who have overcome darkness in their life typically have a fire inside them that is almost impossible to extinguish ». (En gros : Les personnes qui ont surmonté l’obscurité dans leur vie ont généralement en elles un feu qui est presque impossible à éteindre.)
En attendant, la thèse de Boris Cyrulnik serait la suivante (et tenez-vous bien) : parce que nous aurions été traumatisé·es, nous avons le droit à une vie extraordinaire. Selon lui, « c’est parce qu’on a souffert que l’on peut revendiquer cette façon d’exister qui distingue de ceux qui vivent normalement ». Ceux qui ont été traumatisés comprennent, tandis que les autres vivent superficiellement leurs existences quotidiennes : « les éclopés du passé ont des leçons à nous donner », nous dit-il.
Alors écoutons-nous les un·es les autres ?
Politiser le bien-être : le capitalisme a de la ressource
Maintenant qu’on a dit tout ça, reste que le mot résilience devient problématique quand il se transforme en injonctions à transformer ses cicatrices en paillettes. Et attention, on ne dit pas que ce n’est pas beau (ou pas souhaitable). On dit tout simplement qu’on a le droit de prendre soin à son rythme. Et que le fameux ‘ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort’ a sûrement été inventé par un humain hybride de type virolo-new-age.
Car de la fameuse capacité à « réussir, à vivre et à se développer positivement (...) » décrite par le Docteur comme la déf’ de la résilience, à la capacité à réussir, à vivre et à faire semblant de se développer positivement, il n’y a qu’un pas.
Et ça tombe bien, car à l’occasion de la rentrée littéraire, l’autrice Camille Teste nous a donné (aux Éd. Binge Audio), un peu de grain à moudre sur le sujet avec son excellent livre Politiser le bien-être. Ce qu’on y apprend (en deux mots, vraiment) ? Que le so called « bien-être » est devenu récemment le golden ticket du capitalisme - qui se fourre à l’année environ 4400 milliards de dolls dans les poches en faisant tourner cette industrie (parce que oui, c’en est une).
Le rapport avec la résilience ? C’est que l’autrice pointe du doigt très justement la façon dont nous tombons aujourd’hui sous le joug d’injonctions à bouffer du chou kale, réciter des mantras, et à dire « knock me down nine times and I get up ten ».
Alors, ne nous méprenons pas : bien sûr qu’il y a du bon dans la visibilisation (inédite) des sujets de santé mentale aujourd’hui (qui doit plus aux communautés militantes qu’aux centres de fitness-yoga mais passons). C’est justement ce que nous recommande Camille Teste : faire du self care un acte révolutionnaire. Et pour ce faire, vous avez le droit de prendre votre temps. Celui qu’il vous faut. Même si c’est longtemps.
Aller mieux versus aller bien
C’est tout le sujet de cet article (et le fond du problème) : pour dire qu’on va mieux, il faut ne pas avoir été au top (du tout). D’ailleurs, l’inventeur du terme précise bien que « pour être résilient, il faut d’abord avoir été traumatisé ».
Voici donc la partie pas fun de cet article (c’est vrai qu’on se marrait bien avant), et où l’on se permet de tenter un TW : parlons traumas.
On ne rentrera pas ici dans le détail parce que le monde dans lequel nous vivons tend à être plutôt créatif en ce qui concerne les variations sur le thème du trauma... Mais on peut vous dire ceci : si vous sentez que vous avez besoin de parler d’un ou de plusieurs événements particuliers qui vous considérez (ou pas encore) comme un trauma : parlez-en. Le Docteur Cyrulnik parlait d’ailleurs à juste titre de l’importance des « tuteurs de résilience ». Ce peuvent être des ami·es, des allié·es, ou encore des professionnels de santé mentale.
No need to tell you que vivre en ayant survécu à des évènements traumatiques n’a rien de facile. Et qu’on peut se sentir seul·es - même si la commu’ se pose là. En fait, comme le disait Christine Angot à l’époque (et c’est valable pour toute autre chose) : avec le v*ol, on se démerde. On fait comme on peut, et le plus relou dans l’histoire c’est que ce soit “comme ça”. Qu’on ne puisse pas faire l’expérience de la résilience en un claquement de doigts.
De résilience à divinance
Loin d’engraisser la pâte d’un système capitaliste prêt à tout pour transformer nos blessures en positions de yoga, faire preuve de résilience est un cadeau que l’on tente de se faire à soi. De se valoriser. De se dire que nos vies en valent la peine et qu’elles raconteront bien d’autres histoires que « ça ».
(Et pour celles qui se poseraient la question : non, si vous faites du yoga, on ne vous juge pas - loin de là).
Dans ce post (très intéressant) de @yardiebiggz, on a noté une phrase : « at the end of the day, healing is very bittersweet ». Ce que l’on pourrait traduire par « au final, la guérison a une saveur douce-amère ». Et on la comprend.
Mais si le terme résilience est si utilisé aujourd’hui dans nos communautés, c’est parce que nous avons dû nous battre. Et que nous sommes des survivant·es. Raison pour laquelle on préfère parfois au terme résilient·e le terme « Diva » (y’a quoi ?).
I.Maalèj