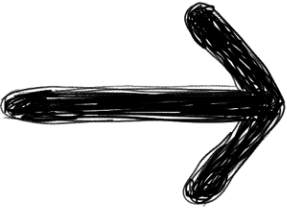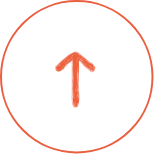Des soirées étudiantes aux safe spaces LGBT+ : comment la fête a changé mon rapport à mon corps
La chronique de Sarah
Bonjour et bienvenue dans le lundi 21 juin 2021 : c’est le solstice d’été, les masques sont tombés, le couvre-feu est levé, et la fête de la musique bat son plein. Bref : on croirait presque (presque) avoir retrouvé un peu de nos vies avant mars 2020. Pour l’occasion, on donne la plume à Sarah, qui nous raconte comment et pourquoi la musique et la fête ont changé son rapport à son corps et aux autres ces dernières années - de ses premières soirées étudiantes bancales et arrosées, à la découverte des espaces de fête safe et LGBT+ à Paris. Welcome dans cette chronique amoureuse de ces cocons de liberté, d’audace et de contestation que sont les espaces liés aux musiques électroniques et tout particulièrement à la musique techno
Découvrir la fête dans un monde pré #Metoo
Il y a eu deux “grands temps” de la fête dans ma vie : d’abord, c'étaient les premières fêtes étudiantes, à l’époque où je croyais que j’allais devenir avocate, prof de français, ou encore hôtesse de l’air (...et où j’ai surtout appris à boire avant de foirer mon année de droit, puis mon Hypokhâgne, puis ma vocation de steward #oups). À l’époque, apprendre à faire la fête (et tout particulièrement en province) était lié à une très forte culture de l’alcool.
En fait, l’équation était simple : peu d’endroits où sortir à part les bars = se retrouver constamment dans des bars ou dans des “soirées apparts”. Sur place, bien sûr, il y avait de la musique, mais il faut dire qu’on terminait plus souvent à beugler les paroles de Blurred Lines de Robin Thicke (#touteuneépoque) qu’à tomber en pâmoison devant la beauté d’un concert en live.
Bref : je sortais beaucoup, j’apprenais à connaître mes limites (ahem), et surtout (surtout), il faut rappeler que nous étions bien avant l’époque #Metoo. De fait, les soirées dans lesquelles je traînais étaient le plus souvent très hétéronormées - et, du haut de mes 19-20 ans, sans aucune éducation féministe, j’étais encore très imprégnée de cette idée qu’on allait en soirée pour (se faire) pécho. Et comme je manquais cruellement de confiance en moi, j’en faisais des tonnes pour bien donner le change.

Résultat : mon attitude, ma manière de me saper, de concevoir mon rapport aux autres (et surtout aux hommes cis-het) était imprégné jusqu’à l’os de male gaze. À me regarder, avec le recul, j’ai l’impression de voir une parodie un peu bancale d’un clip des Pussycat Dolls. Sauf que les Pussycat Dolls étaient cools, qu’elles étaient des artistes, qu’elles maîtrisaient un tant soi peu leur image. Ce qui n’était pas du tout mon cas.
Alors, au bout de quelque temps, ça m’a saoulée : que ce soit mes talons de 15 centimètres qui me défonçaient les pieds, mes fringues super-féminines qui me valaient des commentaires objétisants en permanence, ou les réveils du matin avec le goût du seum dans la bouche - j’avais l’impression d’intégrer des codes qui me plaisaient sur le papier, mais qui, dans le fond, se jouaient toujours à mon détriment.
Et là, patatras supplément épiphanie : je découvre le féminisme, et, dans un mouvement de rage, j’ai envie de tout jeter à la poubelle : les fringues sexy, les soirées arrosées, l’hétérosexualité, Robin Thicke, les Pussycat Dolls, et le mauvais alcool qui te fait faire des trucs que tu regrettes amèrement après. Bref : nous sommes en 2013 et je décide de ne plus faire la fête. Sans rien forcer, sans même devoir me retenir d’y aller.
Alors même que je viens d’emménager à Paris, de changer de ville pour la première fois de ma vie, je raccroche mes habits d’apprentie-teufeuse au placard en me disant : “J’ai saturé, ce chapitre de ma vie est fermé”.
Redécouvrir la fête dans des safe spaces
Je vis en colocation avec une amie de longue date qui est aussi casanière que (la nouvelle version de) moi. Nos vies s’étalent paisiblement-péniblement entre lectures de poésie, lectures de tarot, taf alimentaire à 40 heures la semaine, et études par correspondance. Bref : on ne sort pas, et de toute façon, on n’a ni l’énergie, ni le temps, ni l’argent. Mais quand même : on décide de faire une exception pour le Nouvel An.

Et c’est là, entre deux shots et deux “bonne année” que je rencontre les personnes qui vont changer ma vie pour les années suivantes : une joyeuse bande d’hétéros, de gays, de lesbiennes, de bi·es, de teufeur·euses qui s’inscrivent dans une culture de la fête très liée à l’histoire de la musique techno et de ses communautés. Aka des espaces qui se veulent avant tout safe, et qui sont politisés et militants comme la musique qu’ils défendent. Des espaces où toutes les identités de genre, toutes les orientations sexuelles ont leur place. Des espaces où se saper comme une Déesse de la paillette n’appelle pas à se prendre une main au cul mais plutôt à s’envoyer une bonne dose d’empowerment.
Progressivement, je (re)découvre le plaisir des concerts live, où la claque que la musique te met suffit à te faire décoller du sol. Je redécouvre la joie de barouder en bande dans la ville, au fil des programmations des artistes qu’on adore. Je redécouvre le plaisir de m’habiller, de performer ma féminité pour moi, et pour personne d’autre. Je découvre ma bisexualité, la beauté et le repos qu’offrent des relations qui sortent de l’hétéronorme. Je découvre la puissance toute particulière et précieuse de pouvoir danser en brassière ou en soutien-gorge au milieu d’une foule d’inconnu·es qui ne verront jamais ton corps comme un objet à prendre.
Alors, quand en mars 2020, le monde se met sur pause, quand la fête s’arrête, quand les clubs ferment, que les concerts n’existent plus, soudainement, un trou se creuse en moi : je ne trouve plus ces espaces de décompression, d’expression libre, de jouissance du corps par la danse et la musique, de fusion avec cette communauté qui est la mienne. Où est passée la fête, où est passée la musique ?

Heureusement, des collectifs, comme l’Union des Cultures Festives LGBTQ+, voient le jour et interrogent l’invisibilisation de ces cultures pendant la pandémie. Ils permettent à de nombreuses personnes LGBT+ qui sont complètement isolées des seuls espaces où elles peuvent être elles-mêmes et laisser libre court à l’expression de leur identité - de se sentir moins seules, de tenir le coup en attendant que la fête revienne.
Alors aujourd’hui, à l’heure où la reprise des festivités semble possible, j’ai envie de dire : ENFIN, et MERCI. Merci à ces espaces d’exister, de m’avoir tant appris sur moi-même, de m’avoir permis de me réapproprier mon corps, d’explorer mon identité de genre et ma sexualité librement - sans slutshaming, sans casse-c***** qui pensent que t’as mis une mini-jupe pour leur plaire, sans gros relous qui ne veulent pas comprendre que “non c’est non”.
Alors ce soir, c’est prévu, c’est promis : je ressors mes sapes de Pussycat Dolls pour aller célébrer la musique et la fête. Car nos cultures festives ne sont pas seulement des espaces où le défoulement est possible, non : ce sont aussi des espaces qui nous permettent d’exister, de nous réinventer, de montrer que d’autres modes de penser collectif, et de faire corps existent.
Alors bonne fête de la musique - et vivent la fête libre et les corps qui la vivent librement. <3