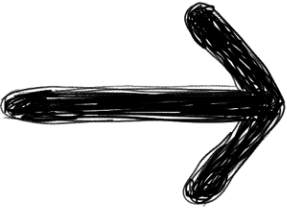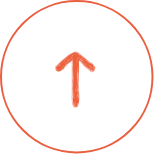On a parlé antisémitisme et guerre des mémoires avec Illana Weizman
Accrochez vos ceintures
En 2022, tu sortais ton essai « Des blancs comme les autres ? » dans lequel tu exprimes ton vécu de la judéité et de l’antisémitisme. Cette année tu as sorti le podcast « Qui a peur des juifs ? » chez Chahut Média, c’était important pour toi d’en parler autrement ?
Le podcast était une proposition. Une société de production de documentaires audio m’a contactée après avoir lu mon essai. Ils m’ont dit qu’ils aimeraient faire quelque chose avec moi car ils avaient déjà traité de différents racismes mais pas encore de l’antisémitisme. Je n’avais pas envie de faire une adaptation de mon livre, j’avais plutôt envie de faire quelque chose qui soit complémentaire. Dans cette série de podcast, il y a donc une partie théorique, sociologique et historique avec des historien.ne.s et chercheur·euses qui prennent la parole, mais aussi une grosse partie de témoignages, sur lesquels j’avais envie de mettre l’accent. Quand on parle d’antisémitisme, mais aussi d’autres formes d’oppression, je trouve que les chiffres et statistiques ne sont pas très évocateurs, je trouve que ça a un rendu un peu froid. Avoir les témoignages, les vécus antisémites, ça permet d’humaniser le propos, de créer une empathie chez les auditeurs, ce que je voulais dans un format podcast que je trouve très intimiste.
Quels sont les points forts que tu as voulu aborder dans ce podcast ?
Les témoignages sont vraiment le cœur battant du podcast. Beaucoup de personnes ne sont pas impliquées dans certaines luttes, pas par haine ni par rejet mais par ignorance. Il y a beaucoup de gens à récupérer en faisant de la pédagogie. Il y a cette volonté de reprendre les bases pédagogiques de “qu’est-ce que c’est l’antisémitisme” et d’humaniser cette histoire là avec le vécu des personnes concernées. Je reçois d’ailleurs beaucoup de messages sur mon compte Instagram (@illanaweizman) qui me disent « wow je n’avais pas réalisé », qui ne connaissaient pas les racines du problème ou comment les même thématiques qui existaient au Moyen Âge (et même avant) se métamorphosent et prennent de nouvelles formes encore aujourd’hui.
Comment ce projet a été accueilli ?
C’est un petit studio de podcast, et en à peine deux semaines, on a fait plus de 10 000 écoutes, donc c’est vraiment une réussite, on ne s’attendait pas du tout à ça. Mais ce qui m’importe le plus, ce sont les auditeurs, notamment les non-juifs qui se rendent compte que l’antisémitisme n’est pas un racisme du passé, contrairement à ce qu’on peut croire. Ce qui me touche encore plus ce sont les messages des personnes juives qui se reconnaissent dans certains témoignages, ou qui sont émues. Des personnes à qui il arrive de s’auto-censurer parce que l’antisémitisme est très souvent minimisé. Ils ne disent pas ce qu’ils vivent et n’arrivent pas à légitimer leurs propres ressentis. Et je suis contente car il y a aussi beaucoup de personnes qui reconnaissent avoir subi de l’antisémitisme, qui vont le dire, en parler, se défendre et ne vont plus se sentir mal à l’aise. Ça pour moi, c’est vraiment une grosse victoire.
Dans ce podcast, tu parles de la difficulté à faire converger les luttes antiracistes, comment en es-tu arrivée à dresser ce constat ? Comment pourrait-on dépasser cette situation ?
C’est un constat que j’ai d’abord fait personnellement : venant de milieux de gauche, je me suis très vite rendue compte qu’il y avait beaucoup de déni et beaucoup de minimisation, toujours ce “oh ça va, quand même les Juifs ils en font un peu trop, il y a pire, il y a d’autres victimes”. Je me suis très vite sentie mal à l’aise, notamment dans le milieu de la gauche radicale, et j’en suis vite sortie. Je me suis retrouvée dans des cercles en non-mixité avec des personnes juives de gauche qui me comprenaient. Lorsque l’on est dans des camps qui sont censés prendre en compte toutes les oppressions, défendre les populations opprimées, c’est très problématique que les Juifs soient vus comme le vilain petit canard.
Pourquoi on écoute aussi peu les expériences antisémites que les personnes juives ont pu vivre alors même que la Shoah a nécessité (et nécessite toujours) un travail de mémoire important (musées, mémorial, programmes d’histoire etc) ?
La Shoah a été un tel moment de violence inouie, inconcevable, que ça a eu un effet déréalisant sur ce qu’est l’antisémitisme du quotidien : la petite phrase, le stéréotype, le petit mot lancé au détour d’une conversation. On a l’impression que la Shoah va faire écran de fumée sur tout l’antisémitisme banal, trivial. C’était donc hyper important pour moi qu’il y ait des témoignages, de la “petite” insulte à la grosse agression, qu’il y ait vraiment tout le panel, tout le nuancier de l’oppression, exactement comme lorsque l’on parle de sexisme : de la petite blague au féminicide. Il y a plein de degrés et d’intensités différentes en fonction des actes et des paroles, ça doit être pris comme un système.
Dans ton podcast, il y a une idée qui ressort : c’est une « guerre des mémoires » qui oppose les mémoires les unes aux autres, comment définis-tu ce phénomène ? En quoi est-ce un problème ?
Il y a cette idée que la souffrance et la mémoire des Juifs prendraient toute la place, et que parce qu’on parle de la Shoah, alors on ne parle pas de l’esclavage, ni de la colonisation, et des autres crimes contre l’humanité. Dans les faits, on ne parle pas assez de la colonisation, et il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus en France. Mais ce qui me paraît très étrange et problématique, c’est quand on dit qu’on parle trop de la Shoah. C’est surtout qu’on ne parle pas assez d’autres crimes contre l’humanité. Il faut parler de toutes les mémoires, de toutes les souffrances. La souffrance des uns n’est pas retirée si on parle de la souffrance des autres. Moi en tant que juive, je veux qu’on parle d’absolument toutes les horreurs commises par la France ou par d’autres empires coloniaux. Et quand on prend des études statistiques, on voit bien qu’en majorité, les personnes qui détestent les Juifs, détestent aussi les Noirs et les Arabes. Si on commence à se taper dessus entre personnes racisées, les racistes et suprémacistes blancs gagnent d’une certaine manière. Donc évidemment, il faut toujours faire des distinctions parce que les racismes ne sont pas les mêmes, il faut avoir des groupes en non-mixité et il faut aussi travailler ensemble dans certains endroits parce qu’on se renforce les uns les autres.
Tu parles du panel de l’antisémitisme, de la petite remarque du quotidien à la Shoah, comment on éduque sur ce sujet là ?
Je pense qu’il faudrait parler de tous les racismes, très tôt à l’école, en expliquant ce que c’est, comment c’est vécu, puis d’en parler à la maison et surtout de parler des points de rencontres entre les racismes. Il y a pleins de vécus communs. Par exemple, entre ma mère qui porte le foulard car elle juive religieuse et une de mes meilleures potes musulmane qui porte aussi le foulard. Il faut éduquer ceux qui ne sont pas visés par le racisme. Il faut aussi parler, même si c’est difficile, car peu de personnes juives osent raconter ce qu’on vit, notamment parce qu’on est peu (moins d’1% de la population en France). Il y a aussi depuis quelques années des groupes, des collectifs (comme @juifvesrevolutionnaires par exemple) dont il faut partager les matériaux pédagogiques au maximum.
À lire et à voir aussi :
Où sont les mannequins arabes dans la mode ?
« Trop noire pour être belle » avec Denisy
« Toutes les indiennes se resemblent » avec Anjali Govindassamy
« Être une femme latina en France »